Deux films à voir dans le désert du 15 août
Chaque été c’est la même chose : entre deux films d’épouvante et de SF, on se rabat sur les énièmes rediffusions de vieux longs-métrages, d'anciennes séries télé, ou sur les films en salle qu’on a raté. Eh bien, au cinéma, ces jours-ci, il y en a deux qu’il ne faut pas louper.

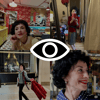
Si vous compilez chaque semaine les sorties cinéma, les films qui se jouent près de chez vous, dans les cinémas indépendants qui ont de bons choix artistiques, ne vous matraquent pas avec le prix des places, vous avez dû observer un phénomène : la persistance, voire la re-programmation d’un film coréen sorti officiellement en 2023, « A Normal Family ». Les directeurs de salle ont dû observer un bouche à oreille qui leur a mis la puce… à l’oreille. Alors profitez’en, ce film est absolument génial.
« A Normal Family » : magistral et glaçant

D’abord, un film coréen, c’est déjà la garantie d’un exotisme rafraîchissant fait de retenue, d’expressivité délicate, de gestuelles, de paysages, de décors différents. Là, on va découvrir, en Corée, l’adaptation d’un livre néerlandais, signé Herman Koch, « Le Dîner », lui-même inspiré d'un fait divers réel, je ne vous dis pas lequel, cela ôterait une part de surprise. Le livre fut un best-seller sorti il y a plus d’une douzaine d’années, et traduit dans le monde entier.
Donc « A Normal Family », c’est le destin de deux familles pas vraiment normales. Elles sont chics, aisées, avec chacune un ado qui vit sa vie en bulle secrète, sans impliquer ses parents. Les parents : deux frères aux idéologies opposées : l’un avocat féroce, doué et matérialiste, flanqué d’une nouvelle jeune épouse que la belle-sœur méprise ; l’autre, chirurgien, dévoué, idéaliste, sauve des vies. Le drame se noue à cause de leurs enfants, une gamine chez l’avocat, parfaite innocente, vive et ravissante, un garçon chez le médecin, plutôt mal dans sa peau, harcelé à l’école. Les premières minutes nous plongent d’emblée dans une violence froide, inconsciente, rigolarde, une altercation à un feu rouge qui explose dans le sang. Bienvenue dans un monde à la fois déshumanisé et terriblement concret, attirant. Dans ces deux familles, les gens sont beaux, apprécient les bons restos, les belles bagnoles, les décors… On se retrouve, incrédule, dans la tête des personnages, à raisonner comme eux, c’est le talent du cinéaste.

Au fil des deux heures tournées au cordeau, sans perte de temps, avec des cadrages précis, des intrigues horlogères et des retournements effarants, il ne va pas nous lâcher une seconde. Rien de surligné dans le jeu, un minimalisme qui exprime tout. L’effroi, le doute, l’incrédulité, l’amour, la bonne éducation… C’est d’un grand, terrifiant raffinement. Le cinéaste nous livre sans pitié une peinture de ce que deviennent nos sociétés, et nos adorables et monstrueux bambins.
Le film déroule, sans pesanteur, une philosophie glaçante. Le bien, le mal, le mensonge, la réputation, le dilemme de la justice et de l’amour parental. Tout cela emballé dans les cosmétiques coréens, la soie italienne, le grand Bordeaux et les baskets à 800 euros pour mômes sans coeur. C’est subtil, vivace et impitoyable.

« Touch, nos étreintes passées » : bouleversant
Un film islandais, à quoi cela peut-il ressembler ? A Bjork ? Aux séries Netflix, genre « Les meurtres de Valhalla » ? Rien à voir. « Touch » est tiré d’un roman qui pourrait être réel, Snerting (qui signifie le toucher, Touch en anglais), signé Olafur Johann Olafsson, lequel a collaboré au scénario. Il raconte le parcours de Kristofer, un veuf septuagénaire qui décide de retrouver son amour de jeunesse. Devant ses épisodiques pertes de mémoire, son médecin lui a prudemment conseillé de « mettre de l’ordre dans ses affaires ». Eh bien, il ne va pas rédiger un testament pour sa fille, il va prendre l’avion pour Londres, où, à 19 ans, plongeur dans un resto japonais, il était tombé fou amoureux de Miko.

Le film ne s’éparpille jamais en indications ; concentré, structuré, dense, il s’attarde plutôt sur le superbe jeu des personnages, surtout le vieux Kristofer, merveilleusement incarné par Egill Olafsson, regard profond, humour, intonations, émotions retenues, sobriété. Il crève l’écran comme on dit, et force la sympathie, séduit par sa sincérité. Le film progresse en flash-backs : Kristofer dans les seventie’s à Londres avec Miko, et au restaurant; Kristofer aujourd’hui résolu à aller au bout de sa quête, plus de temps à perdre. L’acteur qui incarne l’irrésistible, le craquant Kristofer jeune est Palmi Kormakur, le propre fils du cinéaste. Et de fait, il y a un côté « famille » dans ce long-métrage. Une intimité dans laquelle on se glisse avec douceur, délectation.

Non seulement on est charmé par l’histoire, le héros, les chefs japonais, la dizaine de personnages, mais on se retrouve embarqué dans l’urgence du vieil amoureux. On espère, on sent qu’il devrait la retrouver, mais non, il y a tant d’obstacles. La légèreté de la jeunesse dans les seventies s’oppose à la pesanteur des années qui passent, de la mort en embuscade, de la déchirante nostalgie. Il y a de l’action et de la réflexion. Sans lourdeur, sont évoquées la rudesse d’une culture japonaise, les priorités de l’existence, la pudeur de l’âge… Si délicat, si fin, si bouleversant.
Catherine Schwaab












